- Œdipe
- Prix
- Vidéos
- Lire
- Actualités
- Critiques
- Dossiers
- Grande traversée - Moi, Sigmund Freud
- Lettre de démission de l'Ecole Freudienne de Paris J. Favret-Saada
- Hyperactivité de l'enfant
- Loi du 5 juillet 2011 : interview
- Décrets relatifs à l'usage du titre de psychothérapeute
- L'affaire Onfray
- Mai 68 : sommaire
- Dossiers Interview de jacques Sedat à propos de la parution des travaux de François Perrier
- Le cas 'Richard'
- Chronologie
- Autisme et Psychanalyse
- Colloque : « Du Séminaire aux séminaires. Lacan entre voix et écrit »
- Documents concernant Jacques Lacan
- Livres de psychanalyse
- Revues de psychanalyse
- Newsletters
- Enseignements
- Adresses
- Questions
- Loisirs
John Edgar Wideman, Écrire pour sauver une vie, le dossier Till, traduit par Catherine Richard-Mas, 2017, Du Monde entier, Gallimard.
John Edgar Wideman, Écrire pour sauver une vie, le dossier Till, traduit par Catherine Richard-Mas, 2017, Du Monde entier, Gallimard.
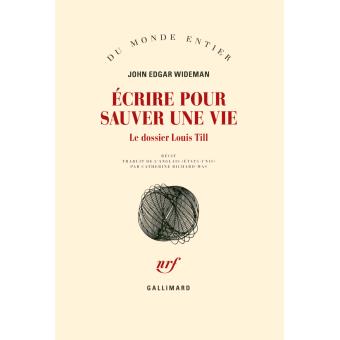
John Edgar Wideman, Écrire pour sauver une vie, le dossier Till, traduit par Catherine Richard-Mas, 2017, Du Monde entier, Gallimard.
John Edgar Wideman est un écrivain noir américain. Il a publié de nombreux romans ou récits dont la complexité, la poésie et l’opacité tragique sont les caractéristiques. Cet auteur n’a cessé d’être aux prises avec une matière autobiographique et sociale atroce dont il tente de dénouer le piège : son frère croupit en prison, et son fils, assassin schizophrène de son camarade de chambrée également. De quoi désespérer et se demander pourquoi, lui, professeur d’université et écrivain célèbre a été épargné et s’interroger sur sa propre culpabilité, le fait qu’il n’ait pas pu ou su éviter le pire : « Suis-je le gardien de mon frère ? », écrivait-il, traduction de Brothers and Keepers.
Il publie aujourd’hui un récit intitulé Écrire pour sauver une vie, le dossier Till, qui raconte l’histoire d’un certain Emmett Till, jeune homme qui s’est fait assassiner, en 1955, par des blancs racistes, dans le Mississipi où il était venu rendre visite à sa famille. Il avait, semble-t-il baratiné une femme blanche. Mais très vite, l’enquête s’oriente vers le père de ce garçon, Louis Till, dont le passé peu glorieux est devenu central dans le procès : il a été exécuté par l’armée, en 1945, pour avoir violé des Italiennes au moment du débarquement allié. Tel père tel fils conclut le tribunal, et l’affaire est pliée. Wideman de tenter, par conséquent, de remonter/démonter cette affaire, ce drame et cette sorte de malédiction qui se sont effectivement passés de père en fils, qui n’en finissent pas, de père en fils de s’abattre sur les frères noirs de l’auteur. Fatherlong, avait écrit autrefois Wideman, reprenant sempiternellement, comme Sisyphe, le rocher des souffrances noires, d’une génération à l’autre, d’un père absent ou destitué, depuis la traite et l’esclavage, jusqu’aux ghettos noirs et à leur violence autodestructrice qui ne fait que continuer la violence raciste et ségrégationniste des Etats-Unis.
Le récit de Wideman n’est pas seulement une enquête, autour du dossier Till, mais également, une introspection, un entremêlement de diverses bribes de récit, fictions et témoignages selon plusieurs points de vue et plusieurs époques, tant autour de la famille Till que de la famille du narrateur. Comment faire émerger un peu de vérité dans un dossier bien mal fichu, presque illisible et assurément fabriqué ? Comment les vérités de la fiction doivent-elles venir à la rescousse, quand la vérité officielle, celle des tribunaux blancs et des témoins corrompus, n’a de toute évidence, constitué qu’une chape de mensonges ? Par conséquent, le texte est au croisement des genres, à l’entrecroisement de voix, allant d’une supposée vérité documentaire, celle du « dossier Till » à des récits plus ou moins fictifs, autobiographiques ou même à des contes (magnifique apologue final), qui, sur un autre mode, concurrencent ou mettent en résonnance, comme un contrepoint, le discours initial.
Wideman est un écrivain qui devrait intéresser les psychanalystes. En particulier parce qu’il pratique une écriture de la signifiance plus que de la signification. Peut-être parce que son nom est lui-même un signifiant pris entre nom commun et nom propre, ce wide man, mène une quête, dans la plus grande opacité, de ce quelque chose (ou de la chose) qui pourrait se pressentir entre les signifiants et remonter — jusqu’où, jusqu’à quand ? « till what ? ou when ? », pour suivre un autre signifiant.
Dans l’un de ses romans, un personnage imagine comment la recherche de la vérité est un travail qui consiste à peler un oignon translucide dont ont pourrait croire qu’il va devenir de plus en plus transparent, pour atteindre, de peau en peau ou de couche en couche, le centre dont on découvre, finalement, qu’il est vide. Dans un autre de ses livres, le jeu est constant entre « I » et « eye, » toute narration étant de ce fait, prise au piège du voyeurisme, et bien d’autres jeux créent des réseaux à la fois poétiques, ludiques et interrogateurs, dans cette œuvre souvent tragique, violente, inquiète, et capable de scruter l’histoire et l’humanité jusqu’au plus abject, jusqu’à ce « litter » dont Joyce n’a pas l’exclusivité, ce déchet, cendres de noirs jetées dans des sacs poubelles, vomissures, défaites morales, qui font une litter-ature au plus près de la lettre et du réel, une littérature qui se débat pour symboliser (« sauver une vie ») et faire sinthome[1].
L’un des grands-pères de Wideman s’appelle French et Wideman n’a cessé d’explorer sa filiation, ses signifiants, jusqu’à la France du commerce triangulaire. Il a épousé une Française et réside parfois en France où il a acheté une maison. Il s’étonne, au cours du récit, du jeu entre les signifiants mer /mère, spécifique à la langue française, comme en anglais, on peut jouer sur l’homophonie entre I et eye, puisque chaque langue a ses équivoques.
L’histoire, chez Wideman est toujours ici et ailleurs, au moins double ; il travaille la mémoire et l’histoire de ses personnages comme Édouard Glissant, remontant à l’Afrique, à l’Europe, il y a bien longtemps. Chez Glissant, l’histoire a toujours commencé avant, loin, dans ce qu’il appelle « le pays d’avant », à peu près inconnu, mais dont il reste des traces. Elle vient également de France, et se continue dans le système de la « plantation ». Wideman participe de cette culture que Glissant caractérise comme celle de la plantation, qui traverse les frontières, unissant, au-delà des pays et des langues, ceux que le système politique et économique a fait cohabiter violemment sur ces terres américaines colonisées qui vont du sud des Etats-Unis au bassin caribéen et au nord de l’Amérique latine. Europe, Afrique, Amérique forment ce creuset de la créolisation qui inclut la violence raciste, la ségrégation, le métissage, des contacts de cultures, le syncrétisme[2]. Wideman, qui connaît la Martinique, (il a publié The Island Martinique en 2003), se reconnaît dans ces histoires-là. Bien qu’il soit un homme du nord (né à Washington, il a grandi à Pittsburg et étudié à Philadelphie), il englobe dans son récit le sud esclavagiste (Mississipi, Missouri, Caroline) dont remontent toujours, comme une origine qui a prise sur les individus et la communauté noire, la ségrégation et le racisme qui continuent à détruire les noirs physiquement et culturellement. Il semble que depuis n’importe quel point de l’histoire de n’importe quel noir américain, on arrivera toujours à cette histoire à plusieurs fils[3].
L’histoire d’Emmett Till conduit le récit dans le Sud, ce Mississipi raciste où il est, pour son malheur, venu rendre visite à sa famille, mais également dans cette France de la guerre où Louis Till, le père, a fait partie des unités américaines, et en particulier noires américaines, et a été condamné à mort comme soldat violeur, ayant déshonoré les GIs. L’auteur narrateur mène donc son enquête du Mississipi en 1955, au petit cimetière Oise-Aisne où le père, Louis Till a été enterré (inhumé, caché, recouvert, oublié, renié), dix ans plus tôt, dans un carré à part presque inaccessible.
Au-delà de son enquête historique et policière, Wideman fait un trajet psychanalytique qui, dans un drame reconnaît un symptôme et remonte, par fragments, les pistes encombrées, blessantes et blessées de ces histoires mêlées. Comme dans le travail analytique, il y a quelque chose de laborieux, de pénible, dans cette quête que le livre de Wideman expérimente au plus près de sa propre histoire, n’étant jamais seulement un œil (eye) qui observe, un point de vue omniscient, extérieur, mais également « I », un sujet qui dit moi et sait que son histoire est totalement celle de son personnage et vice-versa. Il n’y a pas d’objet du récit mais des récits mêlés autour de sujets équivalents, fraternels. On passe de Mamie Till à la grand-mère de Wideman, d’un père à l’autre, d’une mère à l’autre, parfois sans crier gare, si bien que le lecteur est un peu perdu dans le jeu des noms propres, déconcerté. Mais il comprend que ce passage incessant est un enjeu essentiel du livre qui allie ou superpose les histoires, dans une relation complexe qui n’est pas seulement de parallélisme ou de similitude, mais d’inclusion, de généalogie. Wideman cherche, s’interroge, retrouve des traces, des témoins, des souvenirs, se perd, n’y arrive pas, n’arrive à rien en fait (leitmotiv d’un livre qui ne sera jamais achevé, réalisé), mais continue, s’enfonce, opiniâtre, parce que c’est une question de vie ou de mort pour lui. Des visions, sortes de rêves plus ou moins éveillés, libèrent de place en place l’écriture et font avancer le récit, comme des fragments de ce qu’on pourrait appeler « vérités », des vérités psychiques, subjectives dont la vérité objective importe peu : qui serait là, en surplomb, quel œil/I, eye, pourrait tout voir, tout savoir et juger, comme les juges blancs ont jugé Emmett Till puis l’ont condamné à mort ?
Le récit de Wideman ne peut être omniscient, par conséquent, ni unique, et c’est pourquoi il se situe hors genre, au frottement des genres récit et documentaire. Le documentaire (autour du dossier Till), que tente l’auteur, se heurte au doute, se fissure parce qu’une seule vérité, la vérité, s’avère mensongère, plus ou moins arrachée aux témoins, suggérée, négociée, tronquée, reconstituée. La fiction ou les fictions que Wideman entrevoit sont plus crédibles. « Il n’y a pas d’histoire qui ne soit vraie » dit l’épigraphe, citant un grand auteur nigérian anticolonialiste, Chinua Achebe, auquel Wideman aurait également pu emprunter le titre « Things fall apart », car cet effondrement, les massacres, la destruction et l’autodestruction, sont au cœur de son œuvre. Un autre roman de Wideman s’intitule d’ailleurs All stories are true : « toutes les histoires sont vraies », et c’est cette forme de vérité de la fiction, ou plutôt de la multiplicité des fictions, qui est expérimentée dans Écrire pour sauver une vie. Là où une vérité dominante ne peut qu’être récusée, fausse par nature, arrangée, factice, l’écrivain propose la pluralité des points de vue. Il raconte, par exemple, le viol des Italiennes, pour lequel Till sera exécuté, du point de vue des femmes, sans éluder la violence, l’horreur, au risque de condamner à nouveau son personnage dont il ne nie pas la brutalité et le caractère assez ignoble.
Comme chez Glissant ou Chamoiseau, l’écrivain invente donc une poétique, bricole les genres, parce qu’il a besoin de faire entendre sa voix, plusieurs voix, donner plusieurs points de vue, mettre en cause la version unique de l’Histoire dominante, briser l’unité du grand récit plein de bonne conscience et de fausseté, l’user au frottement de fragments de fictions qui le grattent, le font éclater comme avec un coin. Il y a certainement des bouts de vérité dans le dossier Till, comme dans le procès de son fils Emmett, mais de quelle vérité s’agit-il ? Comment répond-t-elle des vérités tout aussi irrécusables de la situation des personnages, de la violence faite aux noirs qui se perpétue et les transforme, même s’ils sont criminels, en victimes de leur propre autodestruction[4] ?
Ce qui est émouvant, mais également très profond, c’est que les histoires (celles des deux Till), sont aussi celle de l’auteur, celle des noirs des ghettos où il a vécu, celle des familles du Sud, etc. Sa propre histoire se joue là. L’urgence, la nécessité du travail sur le dossier Till est en raison directe de son propre malheur. Histoire de fils donc, comme l’écrit Doubrovski, auteur-psychanalyste, nous invitant à prononcer fil et fils, dans une totale polysémie[5]. Les générations, les nœuds que ça forme dans la langue française rendent parfaitement compte de ce que vit et raconte Wideman dont le frère et le fils sont en prison. Wideman a échappé au destin de la communauté stigmatisée. Devenu professeur d’université, écrivain reconnu, il porte cependant la double culpabilité et la souffrance de sa famille, se demande comment, pourquoi il a pu être préservé et surtout comment il aurait pu, pourrait encore « écrire pour sauver » ces vies et se sauver lui-même.
Wideman remonte les histoires et les déconstruit, les déparle (dans le langage glissantien), dans une parole à la fois documentée, historisante, et visionnaire. Il est l’halluciné, l’épileptique en transe de son roman, Le Massacre du bétail, qui refait à l’envers le « passage du milieu », cette traversée de l’Atlantique qui mène les Africains de l’être au non-être. Là encore, le discours de maîtrise, le discours, rationaliste, linéaire, n’a pas sa place, une histoire droite, n’est pas pensable, pour de telles déflagrations. Il faut tout défaire, remonter, dans une vision. Une écriture du type roman historique n’est pas à la hauteur de ces histoires nouées qui sont des massacres et des résurrections inachevées, de ces bricolages qui tout de même font de nouvelles vies. Le dossier Louis Till laisse place, également, à ces beaux passages hallucinés, à des pages poétiques et visionnaires qui donnent accès à des éclats de vérités, à des souvenirs apparemment hors sujet mais toujours reliés en fait. Ainsi, l’amour de jeunesse de l’auteur est-il lié au très jeune âge d’Emmet dont Wideman se demande s’il a eu « l’occasion de faire l’amour » avant de mourir, des visions d’avril 1861 où, dans la chaloupe un certain Louis Till, et le narrateur, « I », auraient ramé pour mener les blancs « à leur perdition » (pages105-108), trouent le récit dans des sortes de percées étranges et décousues qui lui donnent une plus grande profondeur et une familière étrangeté. L’auteur tisse de nombreux éléments, et des temps différents, « investissant » de façon subjective des fragments d’histoire : « rien de bien nouveau pour moi, bien sûr, mais avant de tomber sur l’article de la revue Smithsonian, dit-il, je n’avais jamais investi ce moment-là, savouré cette image limpide, cette épiphanie : des esclaves ramant pour mener leurs maîtres à leur perdition. Jamais partagé un bateau avec Louis Till et son équipe, avec de solennels émissaires de la Confédération »[6]…
« Épiphanies », c’est le terme joycien qui correspond le mieux à ces percées, ces flashes, souvenirs, rêves, visions, qui sont comme des remontées de l’inconscient, arrivées dans le récit par associations et métonymies, distractions et digressions, et apportant leur part de vérités, éclairant de fait la réalité du procès, ou le réel plus exactement, qui englobe le su et l’incertain, la vérité du personnage qui passe dans les vérités autobiographiques de l’auteur dont l’histoire personnelle n’est, du reste, qu’un fil de l’histoire collective.
Sauver une vie, c’est se sauver soi-même, car Wideman survit lui-même à cette violence permanente qu’est l’histoire des noirs. La substitution narrative (d’un Till à l’autre, de l’auteur à ses personnages), signifie que c’est la même histoire, qu’une histoire répète l’autre. Pourtant, l’auteur n’explicite pas de liens de causalité, il ne fait pas de sociologie. Les relations entre les histoires ne sont pas expliquées mais impliquées, inextricablement. C’est une même injustice, un même drame qui se poursuit de père absent en fils perdu, dans un pays où les juges sont toujours blancs. On a parfois l’impression que l’auteur est tenté par la mauvaise foi, mettant en cause la validité des témoignages, tâchant de discréditer ceux-ci en insinuant qu’ils ont été forcés, manipulés, triturés, soufflés, etc. Mais il ne réussit pas à disculper son personnage, ne semble pas vraiment y croire. Ce n’est pas essentiel, parce que, de toute façon, Louis Till est une victime, depuis sa naissance, depuis son propre père, etc.
L’auteur se démène entre ces histoires autour d’un dossier à retrouver, à reconstituer, à lire, — dans quel ordre ? — à analyser. Ce dossier Till est à la fois la vérité documentaire, ensemble de témoignages et dépositions, garantie par la loi, l’archive, et un tissu de mensonges plus ou moins extorqués ou suggérés, arrangés, de toute façon suspects d’avoir été influencés par le racisme des juges militaires et des témoins.
À ces mensonges, l’auteur oppose ses fictions, et la vérité de la situation, de l’abjection des noirs. Car il affronte cette abjection — comme il l’a fait dans L’incendie de Philadelphie — ou leur caractère autodestructeur, dans Le Massacre du bétail. Cette abjection est la vérité de la condition et de l’histoire noires. C’est avec ce prisme qu’il faut tout reprendre. L’auteur se trouve alors pris dans ce réseau de fictions, vérités, mensonges, comme dans cet emmêlement de temps et de générations, jusqu’au découragement. Jamais il ne parviendra à faire quelque chose de ce « dossier ». Il consent, finalement, à cette opacité : voilà la vérité, toute la réalité dans sa compacité, ses embrouillaminis, son incompréhensible et sa trop grande crudité/cruauté. C’est tout simple, ça a toujours été comme ça, foncièrement injuste, profondément injuste. Et si les noirs sont coupables, abjects, maris violents, soldats violeurs, pères introuvables, ce que l’auteur ne cherche pas à nier, c’est qu’ils répètent le symptôme de leur histoire. On sent que Wideman est malheureux, parce qu’il ne peut rien excuser, malgré ses tentatives de justification, son effort pour contrer l’accusation, discréditer les témoignages. Il ne réussit pas à excuser, à rationaliser, mais il voit en même temps tout ce qui se presse derrière cette violence, ces abandons, cette abjection.
Comme dans le mystère d’une analyse, il n’y a pas de résolution, de vérité dernière. Ce n’est pas un roman policier. On connaissait le coupable depuis le début, et sa faute. On en a même plusieurs à la fin. De plus en plus de fautes et de plus en plus de coupables. Ou bien faut-il parler autrement, dire : c’est l’histoire ? Le livre ne sauve personne, en fin de compte, ni l’auteur ni les personnages qui sont déjà morts et enterrés ; Emmett a même été déterré, examiné et enterré de nouveau, peut-être mutilé. Toutefois, de cette abjection, naît quelque chose. Le petit conte par lequel finit le livre a quelque chose de très baudelairien (Une Charogne) et rappelle les images poignantes et horribles de L’Incendie de Philadelphie : langue argotique, évocations de choses dégoûtantes à propos d’un ours aux prises avec des abeilles : « Elles plongent loin, très loin vers les tripes roses et sensibles du gars ours… […] Il se roule par terre, étouffe, vomit des semaines de dîners, crache de gros plâtras d’abeilles et de miel […]. » Mais dans toute cette « mixture », ces matières ignobles que « l’ours a dégueulées », survivent les abeilles kamikazes, « [s]ûrement un peu gluantes et la tronche en bouillie, mais deux ou trois encore bien vivantes. Vivantes et toujours aussi risque-tout, aussi vicelardes, aussi dingues » (page finale).
Avec humour, l’auteur achève son livre sur cette fable qui « plairait » à Louis Till qui s’est endormi, cependant, pendant le récit. Au lecteur de méditer la leçon que ces combats d’ennemis aussi héréditaires qu’inégaux laisse entendre sur la survie des plus petits. Au cœur de l’horreur et de la violence, quelque chose continue à vivre et à se défendre.
Il me semble cependant que, contrairement à la littérature romantique d’un imaginaire qui cherche à sauver les personnages, à transformer les destins tragiques en apothéoses, par la magie de symboles poétiques et de significations (mort des héros transfigurés), Wideman, en dépit du projet proclamé de « sauver une vie », sait que son objectif est irréalisable. Il ne sauve ni ne réhabilite personne. Mais comme dans le trajet sinueux, difficile, à l’aveuglette, de l’analyse (on ne sait même pas ce qui se passe), quelque chose passe dans les interstices des rêves, associations, trouvailles, « épiphanies », moments de découragement, répétitions, bonds en avant, retours, visions, révélations. Quelque chose passe tout de même et se passe, si bien qu’on va mieux, qu’on est plus vivant, plus paisible, d’une certaine manière sauf. La reconnaissance, sans fioritures ni triomphalisme, libère. C’est pourquoi le livre assez sombre et malaisé de Wideman se termine par un sourire, le sourire de Till et du lecteur à qui l’on raconte des histoires.
Dominique Chancé [7]
[1] Cf. Jacques Lacan, séminaire le Sinthome.
[2] Cf. également, Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant, Éloge de la créolité, 1989, Gallimard.
[3] Certains Américains, à l’inverse, ignorent ces pans de l’histoire, en particulier certains noirs qui ne veulent pas reconnaître avoir été africains, ainsi que le constate amèrement Rachid Bouchareb dans Little Senegal (film sorti en 2001), soulignant le déni et l’absence de solidarité entre noirs d’Amérique et noirs d’Afrique ou des Antilles. On reconnaîtrait le même déni ou « aliénation », analysés par Frantz Fanon, à propos de la bourgeoisie antillaise, dans Peau noire, masques blancs. Précisément, Wideman a publié Le projet Fanon, du monde entier, 2013. Wideman est, quant à lui, totalement « africain-américain », selon le terme employé couramment aujourd’hui.
[4] Cf. Wideman, Le massacre du bétail, 1996.
[5] Serge Doubrovski, Fils, 1977.
[6] Le dossier Louis Till, page 107.
[7] J’ai travaillé sur ces questions dans plusieurs essais, depuis L’Auteur en souffrance, Puf, mais surtout dans Les Fils de Lear (études à partir de V.S Naipaul, John Edgar Wideman, Édouard Glissant), éditions Karthala et Écritures du chaos (Frankétienne, Joël Des Rosiers, Reinaldo Arenas), Presses de l’université de Vincennes.
- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour publier un commentaire


