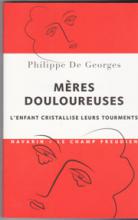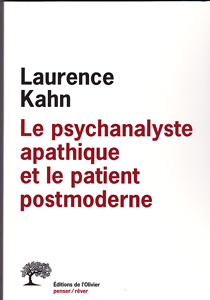- Œdipe
- Prix
- Vidéos
- Lire
- Actualités
- Critiques
- Dossiers
- Grande traversée - Moi, Sigmund Freud
- Lettre de démission de l'Ecole Freudienne de Paris J. Favret-Saada
- Hyperactivité de l'enfant
- Loi du 5 juillet 2011 : interview
- Décrets relatifs à l'usage du titre de psychothérapeute
- L'affaire Onfray
- Mai 68 : sommaire
- Dossiers Interview de jacques Sedat à propos de la parution des travaux de François Perrier
- Le cas 'Richard'
- Chronologie
- Autisme et Psychanalyse
- Colloque : « Du Séminaire aux séminaires. Lacan entre voix et écrit »
- Documents concernant Jacques Lacan
- Livres de psychanalyse
- Revues de psychanalyse
- Newsletters
- Enseignements
- Adresses
- Questions
- Loisirs
La psychanalyse « américaine », ou du bon usage des épouvantails. Note sur Le psychanalyste apathique et le patient postmoderne, de Laurence Kahn.
Critiques du même auteur
Disons-le tout net, le livre de Laurence Kahn, Le psychanalyste apathique et le patient postmoderne, est l’ouvrage de réflexion psychanalytique sur la psychanalyse, ses tendances contemporaines, son épistémologie, son anthropologie, voire sa politique, le plus important de ces dernières années. C’est tout d’abord, et il faut le saluer, un texte argumentatif, conceptuel et qui ne recule pas devant l’exigence philosophique, mais aussi un brillant essai d’histoire intellectuelle sur les métamorphoses de la psychanalyse au sein de l’Association internationale de psychanalyse, étayé sur des lectures de première main, et citant tout un ensemble d’articles et d’ouvrages très judicieusement choisis, et qui s’achève avec une série de notices biographiques et bibliographiques sur les principaux protagonistes du débat, où même un connaisseur de ces questions trouvera à faire son miel.
Sa force est tout d’abord de bien situer la rationalité psychanalytique dans un espace large, celui des débats épistémologiques et de la philosophie de l’esprit contemporaine, en enregistrant avec précision les effets de la pensée de Ricoeur, mais aussi des psychanalystes lecteurs de Wittgenstein, sur le « tournant herméneutique » de la psychanalyse américaine à la fin des années 1970 (autour de Donald Spence). Laurence Kahn rappelle ainsi les enjeux de la féroce critique d’Adolf Grünbaum avec ses effets dévastateurs sur les prétentions de la psychanalyse à revendiquer un statut de science, dans les années 1980, mais aussi, et c’est en un sens assez original, elle s’efforce de démontrer comment la référence à Derrida et Lyotard, référence qui est ici présentée dans un rapport d’opposition frontale à Lacan, offrait des ressources insoupçonnées pour répondre autrement qu’il n’a été répondu par la psychanalyse américaine à la crise du positivisme orthodoxe du freudisme traditionnel. Démarche originale, en effet, car, du moins en France, cette lecture philosophique de la psychanalyse, et surtout du lacanisme, s’est constituée bien davantage en corpus théorique autonome (finalement assez marginal). Qu’on puisse se servir de Derrida ou de Lyotard pour faire pièce au dévoiement ( le mot n’est pas trop fort) de la psychanalyse dans ce triptyque qui sert de cible polémique à Laurence Kahn, et qui est constitué de l’herméneutique, du constructivisme et de l’intersubjectivisme, c’est, à ma connaissance, inédit.
Du point de vue de l’histoire des sciences, ou, si l’on veut, de l’histoire intellectuelle de la psychanalyse, l’événement décisif sur lequel se concentre toute l’analyse, et qui commande la périodisation, c’est l’adresse présidentielle de Robert Wallerstein au congrès de l’Association psychanalytique internationale de 1987, à Montréal. Wallerstein y a en effet introduit le principe d’une psychanalyse dont le « fondement commun » (common ground) seraient exclusivement clinique. C’était à ses yeux le seul moyen de surmonter l’antagonisme grandissant entre les conceptions métapsychologiques concurrentes autour desquelles se déchirait alors l’Association psychanalytique internationale : freudiens orthodoxes, disciples de Kohut, kleiniens, bioniens en rupture de kleinisme, lecteurs de Ricœur, de Roy Schafer et de Donald Spence, etc. Aux yeux de Laurence Kahn, cette tentative de conciliation par la seule clinique fut plutôt pour la psychanalyse le baiser de la mort : elle a consacré et validé une tendance depuis longtemps à l’œuvre dans la psychanalyse américaine, et dénoncée par avance par Freud. En cédant sur la métapsychologie, en la réduisant à un modèle explicatif contingent et dispensable, cette tendance aboutissait en effet à affadir la psychanalyse, et à lui ôter ses « crocs à venin »1. Les indices en sont lexicaux : du rejet de la théorie énergétique des pulsions, relique prétendument dépassée du positivisme de Freud, de l’abandon de l’idée de déterminisme psychique dans la lecture (l’écoute) des associations libres, du remplacement insidieux du terme d’inconscient par l’expression de « monde interne », on passait insensiblement à une doctrine du transfert recentrée sur l’empathie, en parfait contraste avec la « froideur » apathique de Freud et son sens de la dissymétrie objectivante (autrement dit, à l’opposé radical de la « symétrie épistémologique complète » entre analysand et analyste, prônée par Owen Renik), autrement dit à une idée du transfert qui n’est plus une paradoxale résistance, et où le caractère démoniaque de la répétition du sexuel infantile n’est plus au cœur de l’expérience – avec toutes les conséquences pratiques qui s’ensuivent.
En se livrant à un examen aussi fouillé, aussi minutieux, des tendances antipsychanalytiques de la psychanalyse américain, quel coup Laurence Kahn joue-t-elle sur l’échiquier ?
Construire un violent contraste entre la psychanalyse américaine et la psychanalyse française est chez nous un exercice caractéristique. C’est une affirmation d’identité. On se souvient par exemple de la charge de Lacan contre l’ego psychology dans les années 1950. Elle procédait des mêmes ambitions. Le lecteur se frottera néanmoins les yeux en voyant Laurence Kahn trouver du mérite aux thèses conservatrices du grand disciple d’Anna Freud, Leo Rangell, l’ego psychologist par excellence, adversaire bien connu d’André Green dans les années 1970, et contempteur de toutes les innovations cliniques (l’idée de bordeline) comme théoriques (les aménagements du cadre), qu’il aura sa vie durant systématiquement considérées comme des reniements indignes. Il est certain que ce qu’il avait vu en Californie était bien propre à l’horrifier : pensez donc, des kleiniens ultra-orthodoxes de Londres, Bion, puis Kohut, et pour finir, abomination de la désolation, Robert Stolorow ! Il est vrai, pour parler à décharge, que l’historien de la psychanalyse, aujourd’hui, ne considère plus du tout l’ego psychology comme une déviation post-freudienne spécifiquement américaine. On sait, désormais, qu’elle était au contraire une tentative fondamentalement européenne (ou mieux, berlinoise et viennoise) de reprendre le contrôle théorique, mais aussi institutionnel, de ce que devenait la psychanalyse aux États-Unis, sous la houlette de médecins éclectiques qui faisaient alors impunément leur marché dans le corpus freudien, et l’adaptaient à leus besoins2. Simplement, dans le contexte des années 1950, et en jouant sur la vieille fibre anti-américaine des Français, il était plus commode de désigner l’orthodoxie annafreudienne comme une aberration politique et sociale explicable par les précautions prises outre-Atlantique contre la « peste » censément apportée par Freud3, que d’affirmer trop clairement qu’on faisait, à Paris, quelque chose de fort différent de la psychanalyse telle que Freud la voyait – tout en accompagnant l’opération du slogan d’un « retour à Freud » qui ne trompait que ceux qui voulaient bien.
C’est à un geste analogue que se livre Laurence Kahn, qui contourne toutefois la critique lacanienne du « culte du moi » propre à la psychanalyse américaine, en préférant citer les mises en garde d’Adorno dès après-guerre. Elle réaffirme aussi sa fidélité au vrai Freud (qui s’avère être celui que seuls Derrida et Lyotard auraient bien lu, et nullement Roy Schafer, Merton Gill ou James Home). Et elle dénonce dans les errements contemporains du « pluralisme » consensuel post-Wallerstein (car il est devenu de plus en plus difficile d’exclure quiconque de l’Association psychanalytique internationale pour déviationnisme théorique) la même allergie américaine à l’inconscient freudien – cette « réalité psychique » sui generis, essentiellement « intraitable » et « hétérogène », rebelle aux mots d’ordre de la « communication » transféro-contre-transférentielle (si j’ose dire), de la bonne « intégration » et de la réconciliation avec soi dans une « narration » où finalement, peu importe le fictif et le réel, tant que les émotions positives sont au rendez-vous, et que le patient sent intimement qu’on lui fait du bien. Typique, note Laurence Kahn, est cette métamorphose de la doctrine classique du rêve, où, d’objet à interpréter, le rêve devient un état psychique à valoriser pour lui-même à des fins de projection identificatoire essentiellement mutuelle (la « rêverie »), et parfois même mutuellement réparatrice. Au lieu cependant de critiquer le « culte du moi », à la Adorno (ou à la Lacan), Laurence Kahn vise ainsi cette mise en exergue complètement envahissante dans la littérature professionnelle des fragilités narcissiques du self contemporain, ce self que les praticiens américains ne voudraient plus ni humilier par une démonstration d’autoritarisme interprétatif, ni non plus glacer par un silence traumatisant.
Mais pour bien faire valoir pourquoi le vrai Freud, c’est celui auquel nous donnent accès les interprétations de Derrida ou Lyotard, il faut un nouveau tour à la démonstration. Car, Laurence Kahn le sait bien, c’est précisément en s’inspirant de la French Theory, autrement dit, des mêmes Derrida, Lyotard, mais aussi Foucault, et de leurs lectures américaines, en particulier par Richard Rorty, que s’est élaboré le triptyque herméneutique, constructivisme, intersubjectivisme, avec sa conception erronée du transfert comme empathie et son idée de la réalité psychique comme n’étant, au fond, rien d’autre qu’un « texte » qui se réécrit à volonté. Laurence Kahn est ainsi conduite à se battre sur deux fronts. D’une part, il lui faut démontrer que ladite French Theory a fait l’objet d’un contresens massif aux États-Unis, et qu’elle y a été réduite à une sorte de relativisme aussi simpliste que commode qui a infecté la psychanalyse, et, d’autre part, démontrer qu’une juste compréhension des philosophes français et de leur interprétation de Freud sert précisément à établir le contraire de ce que prétendent les Américains : le vrai Freud, selon Derrida et selon Lyotard, n’implique surtout aucune renonciation, bien au contraire, à l’idée d’énergétique, de pulsion, à l’effet de « discorde » occasionnée par l’inconscient dans le narcissisme, le self, ou tous les projets de réconciliation narrative avec soi-même auxquels on réduit aujourd’hui la cure aux États-Unis.
Longs préliminaires, dira-t-on. Ils m’ont semblé nécessaires pour donner idée de l’ampleur du projet de Laurence Kahn, et de la façon dont elle articule une revendication d’ordre clinique, portant sur la pratique même des cures, et la discussion la plus spéculative sur la grande mal-aimée de la psychanalyse contemporaine, la métapsychologie.
J’en viens maintenant aux grandes étapes de son argument, et à sa reconstruction du malheur qui aurait donc frappé la psychanalyse américaine, mettant en danger, conformément aux sinistres prédictions de Freud, sa survie même aux États-Unis.
Il y a tout d’abord une partie du livre qui semblera, je pense, à beaucoup de lecteurs, très convaincante. C’est la reconstruction détaillée d’une certaine trajectoire théorique de la psychanalyse américaine des années 1960 aux années 2000, et qui constitue une sorte d’archéologie du rejet de la réflexion métapsychologique au sens freudien traditionnel, celle-ci étant peu à peu abandonnée aux préférences subjectives des praticiens et aux nécessités contingentes de leur pratique, au profit d’une approche tout-clinique, qui a fini par réduire la communication scientifique entre psychanalystes à l’exposé d’un certain nombre d’interactions entre eux et leurs analysands, d’ailleurs beaucoup moins littéralement rapportées et verbales, qu’émotionnelles.
Laurence Kahn, comme de juste, part de la crise profonde occasionnée dans les années 1960 par la violente prise à partie de l’ego psychology de Hartmann par Ernst Nagel et Arthur Danto. L’épistémologie alors à la mode était le néopositivisme logique, dont Adolf Grünbaum, dans les années 1980, reprendra le flambeau, lui donnant une ampleur critique encore plus dévastatrice4. Disons que dans les années 1960, l’espoir de fonder la psychanalyse sur des bases scientifiques n’avait pas disparu. En s’appuyant sur la cybernétique, sur une neurophysiologie modernisée et bien distincte de ce qu’on estimait à l’époque être la neurologie sous-jacente au projet scientifique de Freud, plusieurs esprits brillants considéraient qu’on pouvait rectifier les bases provisoires de la métapsychologie freudienne, et, surtout, conserver la psychanalyse à l’intérieur du périmètre des sciences psychologiques objectives5. On ne peut pas dire qu’ils aient emporté la partie. Au contraire, ce sont plutôt des positions néo-wittgensteiniennes qui semblent avoir prévalu.
L’œuvre de Roy Schafer est de ce point de vue exemplaire. Laurence Kahn rappelle qu’elle repose sur une relecture de Freud qui en récuse entièrement les ambitions naturalistes, explicatives, positivistes, tout le vocabulaire des mécanismes causaux et de l’individualisation des états mentaux, au profit d’une lecture en termes d’intentionnalité, de raisons, de compréhension, et d’holisme méthodologique. Tout chez cet auteur gravite autour de la notion d’action, étant entendu qu’il n’existe pas d’action sinon sous une certaine description de ce que l’on fait, ce qui autorise, en modifiant cette description, à changer la signification même de l’action que l’on accomplit (si la chose paraît obscure au lecteur, qu’il pense à ce que nous faisons quand nous nous excusons : la même action est redécrite d’une autre façon, on lui donne une autre raison, et elle devient du coup une autre action). Or la pente est glissante, et tous ont d’ailleurs glissé, qui conduit de cette interprétation de la métapsychologie freudienne en termes d’intentionnalité et non de causalité vers la réhabilitation d’un agent à la fois unique et unitaire ultime, et qui serait comme le sujet d’imputation en dernière analyse, le « responsable », de toute cette agency (cet agir intentionnel) à quoi revient la vie de l’esprit. Certes, Schafer prend au sérieux le caractère mental et non physique du psychisme et, plus encore, la possibilité de décrire de façon contradictoire certaines actions, ou de leur donner des raisons incompatibles entre elles, reflète plutôt adéquatement le discours que tiennent les patients sur ce qui les agite.
Mais, au fond, dans cette approche, il n’existe pas réellement de conflit intrapsychique ou, pour mieux dire, il n’existe pas de réel du conflit intrapsychique. Il y a simplement des descriptions de la vie mentale en termes de verbes d’actions antagoniques, en sorte que des redescription (interprétatives) des actions en changent le sens. Ainsi, nous voilà enfin débarrassés des impasses de l’impossible justification empirique de l’énergétique freudienne, et des confusions maintes fois dénoncées entre raisons et causes dans les prétendues explications de la psychanalyse. Mais nous voici aussi conduit à l’idée que la vie psychique se transforme non pas comme on transforme quelque chose de réel (par exemple, son économie pulsionnelle), mais plutôt comme on transforme ou qu’on réécrit un « récit de soi », le tout culminant dans la fameuse formule de Schafer, « soi est un dire ». On voit bien l’usage que Ricœur a fait de ce genre de conception, en la rattachant à son projet herméneutique. Peu importe, à cet égard, que Schafer ne se soit jamais pleinement reconnu dans le « tournant herméneutique » de la psychanalyse américaine. Il y a été systématiquement annexé, Grünbaum se livrant à la même assimilation que Ricœur, dans la mesure où la renonciation à l’explication causale (avec ses corollaires, l’induction, la prédiction, etc.) sert de pierre de touche au rejet de la métapsychologie traditionnelle. La catastrophe, selon Laurence Kahn, provient du fait, qu’elle identifie avec précision, que l’intentionnalité à laquelle Schafer et tous ceux qui s’en inspirent ont eu recours est de nature fondamentalement cognitive, ce qui veut dire qu’elle reconduit inéluctablement un soi non divisé, à un agent responsable de ses actions, à un narrateur de sa propre vie qui n’est plus du tout l’éventuel terminus ad quem d’un processus d’intégration essentiellement fragile et contingent dont, après tout, la cure pourrait être l’odyssée personnelle (Et pourquoi pas ? Il n’est pas défendu de lire ainsi l’adage freudien Wo Es war soll Ich werden), mais, et c’est tout différent, son terminus a quo, ce dont on part, parce que c’est une condition globale d’intelligibilité du processus psychanalytique, son nouveau cadre métapsychologique intentionnaliste.
Sur cette base herméneutique, s’est alors déposée touche par touche une version simpliste, du moins très simplifiée de la French Theory où, en mélangeant bien Derrida, Lyotard, le Foucault de Rorty et le Lacan des départements de littérature comparée, et en secouant le tout avec vigueur, on arrive à ce résultat simple, pratique et immédiatement consommable, qu’il n’existe rien du tout commme du réel en psychanalyse (autrement dit, ni réalité extérieure, ni réalité psychique), mais uniquement des « textes ». Pour les nouveaux constructivistes (Laurence Kahn s’est choisie Richard Geha comme bête noire, et j’applaudis des deux mains), laissons là nos dernières pudeurs : il n’existe même plus de réalisme minimal dans l’interprétation (en d’autres termes, comme dirait Donald Davidson, il n’existe rien du tout de quoi on produise une interprétation, et donc aucun point de référence hors de l’interpétation elle-même, et qui ferait que cette interprétation soit vraie ou fausse) ; il n’existe plus que des fictions, la réalité étant une fiction comme les autres.
Ce qui régule ce relativisme dans la pratique des cures, c’est l’accent mis sur l’engagement émotionnel personnel du praticien à l’égard de son analysand. Laurence Kahn ne semble pas attacher une grande valeur la revendication clinique que les patients d’aujourd’hui ne sont plus ceux d’hier, du moins, quand cette revendication lui paraît être le cache-misère d’une longue série de renonciation dans la théorie et la conduite des analyses. De toute façon, et l’on ne peut à cet égard que lui donner raison, ce n’est pas parce que les patients d’aujourd’hui souffriraient d’altération gravissime de leur sentiment d’eux-mêmes qu’il en découlerait logiquement ou pratiquement que le psychanalyste soit plus ou moins mis en demeure de les suppléer narcissiquement pour leur éviter de revivre les traumatismes (indifféremment réels ou fictifs) du mothering déficient qui les a plongés dans un si triste état. Mais une fois engagé sur la pente toujours plus glissante de l’herméneutique, de la narration de soi, et, pour finir, de sa simple autofictionnalisation pragmatique (pourvu qu’on aille mieux), le transfert est réduit à une fonction de miroir intersubjectif que les partenaires se vouent mutuellement à polir, en se prêtant tour à tour le chiffon. Par conséquent, que le psychanalyste communique au patient ses contenus émotionnels, ses associations, et, pourquoi pas ?, la lamentable histoire de ses propres symptômes, qu’il renonce à toute position de surplomb et toute odieuse et naïve prétention à l’objectivation des mouvements psychiques de son analysant, bref, qu’il s’abandonne aux charmes de la révélation de soi (self-disclosure) à la Renik, rien de plus compréhensible. C’est même l’aboutissement de toute l’affaire.
Or la pierre de touche de cette pratique-là, son centre de gravité (puisqu’il ne saurait plus être théorique ou métapsychologique), c’est la notion d’empathie. Mais elle repose sur un contresens si, du moins, on se réfère à l’usage de la notion chez Freud. L’Einfühlung de Theodor Lipps, que Freud mentionne dans Le Mot d'esprit, est en effet tout le contraire d’une affection mutuelle, vorie d’une affection « en miroir », ou encore d’un effacement fusionnel des bords qui isoleraient un individu en face d’un autre (c’est une posture standard de l’intersubjectivisme contemporain, mais on trouvera sans mal des théories de l’identification projective dite « normale », et prétendûment d’inspiration bionienne, qui font appel à cette idée-là de l’empathie6). Laurence Kahn renvoie sur ce point à la façon dont Dominique Scarfone a traduit la fameuse « neutralité » (Indifferenz), dite bienveillante, mais sévère et « froide », autrement dit « apathique », à laquelle le psychanalyste doit se tenir. Scarfone parle du couple impassibilité / passibilité : car pour pouvoir ressentir sur le mode de l’empathie ce qui touche et affecte l’analyste, encore faut-il qu’il se tienne dans une position « impassible » qui maintienne radicalement la dissymétrie dans l’interaction. Pourt pouvoir être touché par autrui il ne faut justement pas se confondre avec lui dans le contact.
Parvenu à ce point, le lecteur n’a plus aucun doute. Le triptyque herméneutique, narration de soi, intersubjectivisme, qui gravite autour de la notion d’empathie, aboutit à la répudiation du fondement même de la démarche psychanalytique, la « discorde » ; ou le « différend » au sein du soi ou du moi. Comme le dit élégamment Laurence Kahn, ce qui est perdu de vue, c’est tout un système d’étrangetés, où l’on n’est justement pas deux, mais quatre : chacun confronté à son étrangeté interne, et, en plus, à la double étrangeté de l’autre, à soi-même comme à lui-même. L’inconscient est effacé.
Les choses se tendent toutefois lorsque Laurence Kahn expose de quel point de vue elle juge l’ensemble de ses conceptions radicalement erronées et même antagoniques avec le projet de Freud. Il y a deux points, mentionnés en passant, qui donnent une juste mesure de la profondeur des enjeux, et de la maîtrise qu’elle en a. Le premier, c’est la remarque selon laquelle Freud s’est arrêté au caractère « indéterminé » de l’adresse transférentielle pour en inférer qu’il y avait une dimension économique à l’œuvre dans le processus. On est là aux antipodes de la vision lacanienne7, dans laquelle la représentation-but du transfert est immédiatement articulée à un Autre qui vient en opposition signifiante, et qui donne comme une structure de langage à l’inconscient. Car c’est le propre de la parole que d’être adressée et il en irait donc ainsi logiquement du transfert comme adresse. Mais on peut également lire l’indétermination caractéristique de cette adresse comme une déqualification radicale, comme quelque chose qui sera toujours, au contraire, le reste de la symbolisation à laquelle l’adresse à l’Autre est vouée par le simple fait de lui adresser la parole (un peu comme si un cri, un pur jaillissement d’affect phonique, ne pouvant être perçu ou, mieux, entendu que comme parole, se retrouvait transformée après-coup en acte de langage : demande primaire, etc.).
Certes, peut-on en convenir, il y a un destin « pragmatique » de la demande (j'emploie pragmatique au sens du registre propre des actes de langage), mais quelque chose s'y est perdu, et qui est un inconscient qui n'est pas du langage, qui n'en a nullement la structure, et dont on ne peut rendre compte que par une référence à l'énergétique, à la dimension économique. Le second, c'est l'insistance avec laquelle Laurence Kahn remet au cœur de la psychanalyse l'opposition entre l'affect et le quantum d'affect. À ses yeux, sans cette opposition-là, il serait impossible de rendre justice à l'importance du point de vue économique pour la clinique. Car l'affect, sur sa face qualitative, autrement dit consciente ou préconsciente, est trompeur : il est facilement référé à une réponse congruente à la réalité extérieure, et il s'insère trop facilement dans le réseau des signes et des comportements expressifs qui le rationalisent et qui le domestiquent. Mais le quantum d'affect, c'est l'inverse. C'est l'accent inattendu, l'intensité qui perturbe, et qui fait trace du sujet pulsionnel, ce sujet totalement libre à l'égard de ladite réalité extérieure – bref, c'est l'inconscient acéphale. Le quantitatif, l'énergétique, l'économique, voilà tout ce dont nous devrions nous défaire, plaident d'une même voix les intentionnalistes à la Schafer (pour qui la seule énergie qui vaille, c'est l'activité, et qui réécrivent la doctrine de la pulsion sous la forme d'une simple grammaire de l'action, ferait-elle place à des contradictions), mais aussi bien les lacaniens, pour qui rien ne se révèle jamais que dans les filets de la structure et du symbolique.
Jusque-là, tout va bien. Négativement, on voit ce qu’on perdrait à perdre l’énergétique tant vilipendée par les Américains : le dramatisme de la « discorde » interne que cause l’inconscient, le sens de l’hétérogénéité irrécupérable, et, de là, ce qui déclôture par avance toutes les totalisations du sens et de la conscience, du sujet (fut-il le sujet de l’inconscient), comme de l’agent ultime de tous les actes à la Schafer. Mais comment faire tenir debout, autrement que négativement, voire par le détour archispéculatif de ce qui n’est, au fond, qu’une « métapsychologie négative » (comme il y a une théologie négative), un tel inconscient ?
Laurence Kahn a recours aux théories de la « trace » et de l’« architrace » derridienne, ou de l’infantia et de la « phrase-affect » à la Lyotard (dont elle donne d’ailleurs des résumés incisifs et plutôt clairs) – entendues comme autant de figures-limites de ce qu’occulte tout ce que ressaisit, retotalise une narration, un destin subjectif, un acte responsable et, par-delà le moi, bien sûr, tout ce qu’on entend par self ou par sujet. C’est une énergétique repensée en termes d’écriture ou, plus exactement, en termes d’« inscription » et de « touche » affective originaire. Ce « travail » de l’écriture, pose-t-elle, contrevient autant à la logique de la traduction entre systèmes de signes, ou de symboles, ou de signifiants, qu’à toute synthèse communicationnelle, laquelle ne saurait se concevoir qu’en réduisant au silence ce facteur énergétique.
Or les paradoxes se multiplient, ici. On trouvera déjà ironique que ce soient les philosophes, Derrida ou Lyotard qui, finalement s’avèrent plus psychanalystes, sans avoir (ni d’ailleurs revendiquer) aucune notion clinique, que le psychanalyste qu’ils commentent, nommément Lacan, tandis que le psychanalyste en titre, tout clinicien qu’il est, et malgré la multiplicité d’exemples qu’il fournit à ses exégètes, serait au fond la victime de la mauvaise philosophie qu’il a pris pour la métapsychologie de Freud. Mais pourquoi pas ? En revanche, il me semble qu’entre l’énergétique dont parlait Freud et celle reconstruite ici à coup de travail de la trace et de l’écriture, de pharse-affect à la Lyotard ou d’infantia, il y a autant de rapport, pour paraphraser Spinoza, qu’entre le chien, animal aboyant, et le chien constellation : pas même un lien métaphorique, une homonymie. Le quantum d’affect, l’énergie psychique, autant de notions issues d’un matérialisme standard, faisant signe vers des quantifications objectives encore à venir (Freud a passé sa vie à en promettre la formule définitive dans un avenir qui n’a jamais honoré le rendez-vous qu’il lui avait fixé), mais inscrites par avance dans des lois causales de la nature du meilleur aloi. Pour arriver, ou retourner, au « vrai » Freud selon Laurence Kahn, il faut donc le réécrire en entier, et lui prêter une vérité post-métaphysique cachée, aux antipodes des procédés argumentatifs, des principes rationnels et de l’épistémologie qu’il n’a pourtant cessé de revendiquer. Il faut, et l’ironie se fait là plus acide, prêter à son « texte », à sa rhétorique, à son style (Laurence Kahn mentionne à ce propos Au-delà du principe de plaisir), des vertus plus véritables ou plus véritablement freudiennes que les thèses explicites que ce même texte véhicule. Mais on aura du mal, à ce compte, à justifier la « froideur » ou l’apathie freudiennes, si elles ne se justifient pas sur de meilleurs fondements qu’une esthétique de la trace à la Derrida, ou de la phrase-affect à la Lyotard. Ni l’un ni l’autre, d’ailleurs, ne donnaient à leurs réflexions un pouvoir critique sur la pratique effective de la psychanalyse. Ils restaient philosophes, tandis qu’ici, on nous demande de considérer ces mêmes analyses (rien ne leur a été ajouté, rien ne leur a été retranché) comme des contributions internes à l’élaboration psychanalytique elle-même, voire comme des fondements normatifs pour une métapsychologie renouvelée. C’est encore, selon un geste connu, vouloir faire prendre le retournement de Freud par la philosophie pour un « retour à Freud ». Oui, cette froideur apathique sera à bon droit jugée cruelle, et autoritaire, et gratuite, si elle n’est pas fondée « objectivement » au sens le plus plat et le plus banal de l’objectivité – celle de la science et de son universalité – et si elle se revendique juste de la spéculation post-métaphysique.
Et nous revoilà à la case départ. Si cette prétention à l’objectivité scientifique ordinaire (garante de la distance critique que le psychanalyste peut alors à bon droit conserver à l’égard des démentis que lui oppose son patient, par exemple, comme de toutes les autres manifestations de sa subjectivité consciente), si cette prétention est insoutenable, comme l’ont établi les critiques qui ont pris au mot les revendications de scientificité maintes fois réitérées par Freud (lequel savait fort bien ce qu’il faisait en cherchant son salut du côté de la science, et pas de la philosophie), alors on doit chercher une autre voie. Les Américains (du moins certains) ont alors l’air moins stupides. Le problème est bien la construction d’une alternative rationnelle (et donc objective) au positivisme de Freud et à son naturalisme explicite et revendiqué. Or il n’y a pas foule de candidats plausibles, et la solution intentionnaliste ou néowittgensteinienne à la Schafer, Laurence Kahn en convient d’ailleurs jusqu’à un certain point, est de loin la plus naturelle8. Il est vrai qu’elle ne donne pas au psychanalyste un savoir objectif au sens de la physique ou de la biologie sur les processus à l’oeuvre chez le patient – ce savoir que Freud, comme Grünbaum l’a bien démontré, pensait obtenir par induction « convergente » (à la Whewell). Mais pour conserver la distance objective, voire le surplomb inintimidable requis pour la « froideur » et l’apathie dont il est question ici, bref, pour échapper aux séduction de l’empathie et de l’intersubjectivisme débridé, un savoir « scientifique » (au sens des sciences naturelles, qui faisaient référence pour Freud) n’est nullement nécessaire. Il suffit juste au psychanalyste d’avoir ses raisons (et que ses raisons soient objectives) de répondre aux mouvements de son patient, ou de les interpréter ainsi et pas autrement, et de se comporter avec lui de telle façon et pas d’une autre, etc. Car les raisons se hiérarchisent de la moins bonne à la meilleure, et il n’en faut pas plus pour une saine métapsychologie que d’offrir des critères pour décider de ce que valent nos raisons, quand nous examinons e façon critique nos pratiques.
Or s’agit-il d’abord et avant tout d’épistémologie de la psychanalyse ? J’en doute, au fond. L’expression « anthropologie psychanalytique » ne vient qu’une fois sous la plume de Laurence Kahn (p.24). Elle se réfère alors aux intentions de Freud touchant le message de la psychanalyse (ou ses « crocs à venin », ce qui n’est pas tout à fait un message), et à ses craintes que les Américains ne le ratent complètement. Or il me semble que c’est ici plutôt d’anthropologie, voire d’anthropologie morale qu’il s’agit, et pas du sens objectif des concepts ou des principes pratiques freudiens et de leur éventuelle déformation par les Américains. Suivons alors cette piste : le point de désaccord entre les Américains et « nous » (car je partage l’ essentiel des répugnances de Laurence Kahn, et je suis bien persuadé qu’elle ne peut trouver, en France, qu’un écho favorable à ses critiques de l’épouvantail de la psychanalyse américaine), ce point de désaccord n’est pas d'abord d’ordre conceptuel ou théorique, mais il porte sur une certaine manière d’être avec autrui, ses malheurs, ses souffrances, et sur la façon dont les représentations sociales, culturelles, et finalement scientifiques et psychanalytiques s’organisent pour les prendre en charge, voire pour y porter remède. C’est ainsi notre anthropologie contre la leur, notre « critique du moi » contre leur « culte du self », notre préférence pour la critique philosophique spéculative en surplomb de la science contre la leur pour une philosophie de professionnels de l’argumentation au service des scientifiques, ou encore, dans un autre registre, mais qui compte éminemment ici, notre façon de dissocier avec acharnement la psychanalyse de la psychothérapie contre leur façon de sans cesse les ré-entrecroiser (on pourrait continuer la liste, bien sûr).
Mais s’il s’agit bien d’anthropologie (et de l’effet de ces anthropologies sur nos manières de s’approprier Freud), alors il y a un coût. En effet, le propre de l’anthropologie, comme méthode, c’est le comparatisme et, par voie de conséquence, la réversibilité exigible des perspectives. Un lecteur un peu entreprenant pourrait se proposer, ainsi, de retourner l’argument de Laurence Kahn. Il se mettrait dans la peau des pauvres Américains, autrement dit, il nous regarderait par les yeux de l’épouvantail, et il se demanderait comment il est possible qu’en France, on imagine que des notions comme l’écriture derridienne ou la phrase-affect de Lyotard peuvent effectivement « justifier » la froideur et l’apathie du praticien. Quels environnements culturel et universitaire (littéraire plus que médical), mais aussi social et politique (hostile aux idéaux libéraux, ou à l’institution du self), contextualisent-ils notre anthropologie si radicalement pessimiste, et la conduisent-ils à se prendre pour une vérité dernière sur l’Homme (pensé à partir de sa « face sombre ») ? Pourquoi même est-il chez nous si difficile de ne pas faire de ce pessimisme tragique le gage de l’authenticité de la démarche psychanalytique ?9 De quoi est donc fait le French Freud ?
La prétention psychanalytique à l’immunité sociologique est une chose. Il n’est pas sûr que cette prétention-là vaille toujours ce qu’elle coûte, au poids de la méconnaissance de leur situation réelle que la payent les psychanalystes. J’irais plus loin. Si les choses doivent bouger, ce genre de mise en perspective réflexive (autrement dit s’appliquant à nous-mêmes, et pas juste aux « autres ») est peut-être nécessaire, et pas forcément si douloureux. La psychanalyse pourrait y gagner un degré de liberté à l’égard d’idées sociales qu’elle brasse plutôt aveuglément, en croyant les avoir formalisées dans ses termes à elle. Au prix d’une abstraction plus rigoureuse, et donc de la recherche d’invariants d’ordre supérieur, on y gagnerait une prise plus concrète sur les faits. Ce n’est probablement pas ce à quoi Laurence Kahn pensait en se lançant dans sa diatribe, mais l’extrême qualité de son travail m’a fait espérer un retour au moins aussi pertinent sur ce qui chez nous va sans dire, y compris dans notre défense de notre « vrai » Freud à nous.
- 1.
Aux critiques de Laurence Kahn, j’en ajoute une. Cette tentative de donner à la psychanalyse un fondement commun de nature purement clinique, indépendante de tout cadre métapsychologique a priori, est solidaire du ravalement de la psychanalyse à un procédé psychothérapeutique évaluable par ses effets en termes quantitatifs. C’est le même Peter Fonagy, engagé dans une dispute homérique avec Harold Blum, défenseur de la métapsychologie freudienne traditionnelle, qui a pesé de tout son poids pour une réglementation normative incroyablement tatillonne des thérapies psychologiques en Grande-Bretagne ! Où l’on voit, en somme, le scientisme débridé le plus stupide découler naturellement des ambitions humanistes parées des plumes de la raison et du progrès en psychanalyse...
- 2.
Sur ce point, voir la fin du livre de Robert Makari, Revolution in Mind. The Creation of Psychoanalysis, Harper &Collins, 2008.
- 3.
On oublie souvent que ce mot a été attribué à Freud par Lacan, qui disait le tenir de la bouche de Jung. Ce dernier, interrogé à ce sujet, n’en avait toutefois aucun souvenir.
- 4.
Je rappelle, car Laurence Kahn sur ce point peut laisser le lecteur dans un certain flottement, que Grünbaum est un adversaire farouche de Popper, et qu’ils ne peuvent en aucun cas être rangés sur la même étagère. Pour Grünbaum, Freud s’est justement donné les moyens techniques de faire de la psychanalyse une authentique science inductive. Il a montré, par exemple, que la critique de Popper sur la prétendue infalsfiabilité des hypothèses freudiennes est erronée, et que Freud, épistémologue génial, avait découvert avant la lettre le principe de construction des hypothèses à la Quine-Duhem. C’est précisément parce que Freud est un grand scientifique naturaliste que l’échec de la psychanalyse est intéressant, aux yeux de Grünbaum.
- 5.
Laurence Kahn n’en souffle mot, mais un tel projet scientiste n’a certainement pas disparu outre-Atlantique. Dans les développements qu’elle consacre à la notion d’empathie, elle mentionne évidemment l’usage diffluent et moralisateur qui en est fait à peu près universellement dans la littérature, en oubliant le nouveau soutien que cette idée a reçu des recherches contemporaines en neurosciences, depuis la découverte providentielle des neurones miroirs, qui est en passe de se transformer en un véritable « paradigme explicatif » (avec la nuance passe-partout qui s’impose quand on est réduit en épistémologie à ce genre de notion). Or, bien des auteurs à la mode, comme Allan Schore, spéculent ouvertement sur la contribution de ce mécanisme à la genèse affective du psychisme humain, dès les premières interactions entre l’enfant et la mère, en revendiquant par là de refonder neuropsychologiquement la psychanalyse, et en citant non seulement Kohut, mais Winnicott.
- 6.
C’est un autre point de désaccord avec la reconstruction historique de Laurence Kahn. Je crois qu’elle sous-estime le poids de la référence à Bion et à la notion désormais complètement confuse d’identification projective dans le développement des approches intersubjectivistes. Elle cite assurément Christopher Bollas, en passant, mais c’est un phénomène bien plus vaste et envahissant. L’histoire des contresens sur Bion est en tous cas fort éclairante, et ce qui nous manque, c’est peut-être un Bion « français », dégagé de sa gangue empathico-intersubjectiviste. Il y a chez Laurence Kahn de bonnes brosses pour décrasser ce Bion-là.
- 7.
Plus exactement, aux antipodes du Lacan de Laurence Kahn, où il n’est jamais question d’objet (ou d’objet a) ni de réel, et moins encore de l’écrit ou de la lettre, juste de structure et de symbole. Mais c’est une autre histoire.
- 8.
À la condition de ne pas donner de l’intentionnalité le traitement habituel, et qui, Laurence Kahn l’a bien vu, est cognitif. L’intentionnalité décisive, c’est celle du désir, et les moyens logiques et linguistiques de la caractériser sont bien distincts. Il est vrai que Schafer les a manqués. Dans mon examen de la Traumdeutung, j’ai essayé de montrer à quoi ressemblerait une telle analyse intentionnelle (au moins dans le cadre de la première topique), en se réglant sur l’usage freudien de la notion d’Absicht (visée). Bien que mon travail ait une vingtaine d’années, et que je n’en défendrais plus de nombreuses aspects, le cœur de l’argument me paraît encore tenir. Voir P.-H. Castel, Introduction à la lecture de « L'interprétation du rêve » de Freud. Une philosophie de l'esprit inconscient, PUF, 1995.
- 9.
On aurait tort de croire l’entreprise chimérique. Alain Ehrenberg, dans La Société du malaise, Odile Jacob, 2011, se livre précisément à cet exercice : montrer comment les deux versions de la psychanalyse, l’américaine, centrée sur le caractère, puis le self, et la française, centrée sur le sujet, reflètent des versions concurrentes de l’individualisme, et des types de société et de rapports aux inégalités bien distincts. Je tiens cette approche anthropologique et comparatiste pour extrêmement féconde. Non seulement elle liquide les illusions sur les mystérieuses« erreurs », pourtant « évidentes », voire les « fautes éthiques » commises par les gens d’en-face dans leur appréciation de l’existence et de sa valeur, mais elle dissipe aussi toutes sortes d’illusions sur les bases cliniques revendiquées par les uns et les autres. Lorsqu’on rattache la découverte des personnalités borderline à la question de la crise de notion de self et de personnalité dans la culture des années 1980 aux États-Unis, et qu’on lit non seulement Otto Kernberg, mais Christopher Lasch, les types décrits par les Américains changent complètement d’aspects.